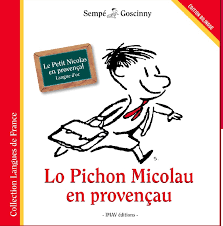 Michel Alessio
Michel Alessio
Traduire du français dans une autre langue de France a aujourd’hui quelque chose de paradoxal.
Sauf exception, en effet, au XXIe siècle, tous ceux qui parlent basque, breton, corse ou francique connaissent le français, c’est même le plus souvent leur langue première.
Ils n’ont donc pas besoin, dira-t-on, de lire ou d’entendre dans leur langue un message traduit du français –je pense à la bataille des annonces en occitan dans le métro de Toulouse–, ou de disposer de traductions d’Apollinaire, de Camus, de Simenon… ou de Goscinny, comme je l’ai fait, avec d’autres, pour le Petit Nicolas.
On peut considérer que ça ne sert à rien de traduire, qu’il est inutile de perdre son temps à redoubler dans une version dérivée, redondante, ce à quoi on peut directement accéder en version originale.
Cela semble aller de soi et je m’empresse de dire que je me rallierais à ce point de vue s’il s’agissait de traduire inconsidérément tout et n’importe quoi. C’est un des « arguments » des adversaires de la pluralité, que j’ai souvent entendu dans mes activités professionnelles : « On ne va quand même pas traduire le code civil dans les 75 langues de France, vous vous rendez compte ?! »
En fait, pour les langues de France comme pour les autres, il s’agit de faire preuve de discernement dans ce qu’on veut traduire, et il est dès lors très réducteur d’aborder l’affaire sous le seul aspect utilitaire, comme si la traduction, comme si le langage n’étaient qu’une question de communication.
En termes de communication, traduire un bouquin du français au provençal, en 2016, c’est en effet complètement inutile. On n’en a pas besoin, ça n’apporte rien aux bilingues que sont tous les locuteurs de provençal. La théorie de l’information nous dit que ça n’ajoute rien au message, et c’est vrai.
Mais le langage ne se réduit pas à de la communication, et il faut l’étudier dans toute la variété de ses fonctions.
En l’occurrence, pour une langue déshéritée comme l’occitan, cette pratique spécifique du langage qu’est la traduction a une fonction de légitimation et de reconnaissance symboliques indéniable. À condition que l’objet à traduire soit bien choisi : il faut que ce soit une œuvre représentative et significative. Traduire les 3 280 pages du code civil –j’ai vérifié le nombre– n’aurait aucun intérêt.
En revanche, choisir quelques textes fondamentaux, ça peut être une grande avancée symbolique et politique ; c’est ce qu’a fait la Révolution en traduisant la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen en basque, en breton, en allemand, en occitan, dès 1790.
Traduire le Petit Nicolas n’enferme peut-être pas le même enjeu, soyons modestes, mais observons lucidement la situation sociolinguistique de notre pays : qu’un grand classique de la littérature de jeunesse soit publié par un éditeur professionnel (et parisien), selon les mêmes exigences de qualité matérielle que l’original, en corse, en breton, dans quatre créoles différents, en picard et bientôt dans toutes les langues de France, « c’est bon pour nous », c’est quelque chose qu’il ne faut pas sous-estimer. Ça « fait exister » lesdites langues, ça les légitime.
Je rappelle dans mon introduction qu’une langue vivante, une langue « de plein exercice », ce n’est pas seulement une langue que l’on traduit, mais aussi une langue dans laquelle on traduit. C’est une langue qui n’est pas cantonnée à certains emplois, mais qui met en œuvre toutes ses fonctionnalités : les pratiques de discours, l’écriture, l’intraduction comme l’extraduction.
Henri Meschonnic disait : « Dans le langage, c’est toujours la guerre ». Il disait aussi que dans l’acte de traduire, c’est toute une théorie du langage et des rapports entre les langues qui se dévoile, de manière implicite et impensée.
Permettez-moi deux observations à cet égard, qui me paraissent illustrer pleinement des rapports de force qui se dévoilent à la faveur de la traduction. De manière impensée, c’est-à-dire dans l’ordre des représentations.
Après avoir hésité, l’éditeur a décidé de sortir le Petit Nicolas en provençal en édition bilingue, les deux langues « en regard », en vis-à-vis. Mais dans la maquette qu’il m’a envoyée pour relecture, le provençal était sur la page de gauche et le français sur celle de droite. J’ai demandé que cet ordre soit permuté, et qu’on mette le provençal sur la page de droite. Pourquoi ?
Parce que je voyais dans la disposition prévue la matérialisation inconsciente d’une hiérarchisation des langues, projetée sur le papier. Il est évident que c’est la version traduite qui fait la particularité, l’intérêt de cette édition, c’est elle qu’il s’agit de mettre en relief et de donner à lire : le texte original est déjà largement diffusé par ailleurs, à milliers d’exemplaires, et ne sert ici que de support à la traduction.
Or, la page de droite est par excellence la page de la lecture, c’est celle vers laquelle le regard se porte spontanément quand vous ouvrez un livre ; les pages de titres sont toujours celles de droite, y compris pour les chapitres à l’intérieur d’un volume, on dit que c’est la page « noble », etc.
Vous voyez où vont se nicher les représentations concernant les langues et leur importance relative !… L’éditeur a bien voulu entrer dans mes raisons, et j’ai obtenu que la maquette soit entièrement recomposée avec le provençal sur la page de droite, puisque, dans cette édition, c’est lui qu’il s’agissait de mettre en évidence.
(Parenthèse historique : en fait, ce n’est pas par hasard que cette réflexion m’est venue de la mise en parallèle du provençal et du français. Dès le début de leur mouvement de renaissance littéraire au XIXe siècle, Frédéric Mistral et ses amis écrivains ont systématiquement publié leurs œuvres avec une traduction française en regard. Cela symbolisait pour eux la mise à égalité des deux langues, la restauration d’une égale dignité. Mais en réalité, on constate que la version provençale, pourtant version originale, est toujours sur la page de gauche, le français à droite.
Mieux : non contents de cantonner la version originale des œuvres sur la page de gauche, les éditeurs allaient jusqu’à l’imprimer en italique, la traduction française étant, elle, en romain [en lettres droites, courantes] ! Ce qui se concrétise par là sur le papier, c’est, dans la volonté même d’y échapper, la perpétuation d’un rapport de domination, ce dont les intéressés ne semblent pas avoir été conscients, ou plutôt qu’ils avaient complètement intériorisé… Vous comprendrez que je me sois montré sensible à cet aspect des choses… Dans le langage, c’est toujours la guerre…)
Autre exemple de ce que la mise à l’épreuve de la traduction peut révéler de notre rapport au français, jusque chez certains partisans des langues de France et de la pluralité culturelle. La parution de ce petit livre a été signalée favorablement dans plusieurs journaux régionaux en Provence, mais l’un d’entre eux a fait une critique féroce de ma traduction. Un véritable éreintement.
Il est intéressant de voir en quels termes. D’abord l’auteur du compte rendu parle, en provençal, de fautes de traduction, et non pas d’erreurs (parce que, pour deux ou trois mots il aurait fait d’autres choix que moi) : on est dans le registre moralisateur et culpabilisant de la faute donc, comme en français. Je rappelle qu’il n’y a qu’en français qu’on parle de fautes d’orthographe, par exemple…
Passons. Mon contradicteur me reproche aussi l’emploi de l’apostrophe pour noter des élisions, nombreuses pourtant en provençal, chez les écrivains comme dans le parler courant. Dans le contexte, en outre, c’est un des moyens dont je me suis servi pour rendre le parler infantile et familier du petit personnage et de ses copains. Quel est l’argument avancé pour censurer mes élisions ? « Ce n’est pas correct en français, ça ne l’est pas non plus en occitan » !…
Et bien sûr, ce discours puriste culmine sur les questions de graphie -vous savez que c’est une pathologie collective chez ceux qui s’occupent d’occitan. Depuis deux siècles on s’entretue pour des histoires d’o et d’a. Disons que j’applique rigoureusement le code de la graphie classique de la langue, mais en exploitant les ressources qu’il offre dans la notation du dialecte provençal, de manière que celui-ci s’en trouve allégé de quelques incohérences.
Alors là, sacrilège ! Il n’est plus question dans l’article que de respect des règles mises en place, de correction graphique, de normes qu’il faut suivre, de choix auxquels il faut se tenir, etc. J’ai répondu à mon censeur : « Pourquoi ne pas mettre en place une police de la langue, tant que vous y êtes ? » Il n’a pas publié ma réponse…
Mais vous avez compris où je voulais en venir : il y a des gens qui n’arrivent pas à s’enlever de la tête le modèle de la langue française, cet archétype auquel toutes les autres langues devraient se conformer. Et dans la pratique de leur propre langue, ils ne rêvent que de reproduire les modes de fonctionnement que l’Histoire a imposés pour le français : en deux mots, surveiller et punir. Comme si leur modèle, c’était l’Académie française et son « bon usage », et qu’ils ne rêvaient que de fulminer des normes, des censures et des anathèmes.
Mais pour moi, pratiquer l’occitan c’est tout le contraire de cela. C’est une langue en liberté, une langue de liberté d’expression. Elle a payé le prix de cette liberté. Et cette leçon est généralisable à toutes nos langues. Il faut les émanciper. Arrachons-nous au modèle coercitif et punitif du fonctionnement d’une langue, au moment d’ailleurs où, même en français, il commence à perdre de son autorité et de son emprise… Assumons la pluralité des moyens d’expression, la liberté des locuteurs, la diversité interne à toute langue.
De toute façon, dès le premier mot prononcé en occitan, en créole, en corse, en flamand, nous sommes déjà dans un contre-modèle, c’est l’Histoire qui l’a voulu, nous exprimons une contre-culture. Alors assumons-le et, sans chercher à entrer dans le moule encore dominant, ce serait suicidaire, inventons d’autres manières de vivre les langues de France.
Voilà deux ou trois choses que cette expérience de traduction m’a permis de mieux penser…
